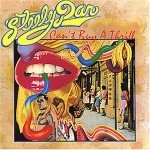CHRONIQUES : (PLEASE) DON'T BLAME MEXICO PRESENTE
PRINCE AND THE REVOLUTION / Purple Rain (1984)

Comme à Michael Jackson, autre mastodonte de la pop mainstream des années 80 – je ne me suis intéressé à Prince que très récemment. J’étais bourré d’a priori quant à cet artiste, je trouvais ses changements d’identités (The Artist, The Love Symbol) et ses accoutrements absolument ridicules, j’avais en tête l’omniprésente image du nabot pseudo-lover avec ses brushings de secrétaire médicale de province, et surtout je haïssais « Purple Rain », le morceau. Je n’avais donc jamais vraiment écouté Prince. Et puis un jour, un ami m’a fait écouter « When Doves Cry » en voiture – lieu souvent déterminant pour apprendre à aimer, ou non, un groupe ou un musicien, la voiture. Il m’a expliqué à quel point ce single, n°1 des charts américains en son temps, pendant plusieurs semaines devant le rival Michael Jackson, était révolutionnaire. En effet, il réussissait le tour de force d’être un morceau de danse implacable (il a dû traîner des millions de personnes sur le dancefloor depuis 1984) sans utiliser de basse ! Pour conduire le groove de son morceau, Prince ne se sert que de la programmation rythmique hyper-simpliste et du placement de sa voix. Un gimmick de synthé sur les refrains et le tour est joué.
Je me suis alors rendu compte d’à quel point les approches de Prince et Michael Jackson était opposées : Michael Jackson jouant sur la surenchère, l’empilement des arrangements, des voix, des couches de sons pour atteindre un paysage sonore saturé d’informations et compact ; Prince misant davantage sur les vides, les espaces entre les sons, adoptant une esthétique plus étirée – ne serait-ce qu’au niveau de la durée des morceaux. Pas un hasard si des gens aussi divers que Spoon, Mathieu Boogaerts ou les Neptunes, qui partagent ce même goût pour le groove dégraissé et la binarité simple, révèrent autant Prince.
Pourtant, Prince n’est pas à proprement parler un artiste « minimaliste », c’est même tout le contraire. Sur l’album Purple Rain (1984), presque plus encore que sur le baroque Around The World In A Day (1985) ou le varié Sign O’The Times (1987), Prince essaie de caser toute la (les) musique(s) qu’il aime. Le plus souvent au sein d’un seul et même titre. « Let’s Go Crazy », qui ouvre le disque, est une sorte de maelström hallucinant où il étanche sa soif de pop totale avec ses gros riffs hard rock qu’il recouvre de synthés kitschissimes, des chœurs soul frénétiques et une boîte à rythmes entêtée ultra-reconnaissable avec ses petits roulements concassés. Il enchaîne avec « Take Me With U » où une intro glaciale laisse vite la place à un pop song lumineuse avec option quatuor à corde, chœurs féminins un chouia too much… et poum-tchack synthétique inflexible. « The Beautiful Ones » pourrait être une ballade de Stevie Wonder interprétée par Kraftwerk interrompue par un accès de démence ‘stadium rock’… mais toujours encadrée par cette fameuse boîte à rythmes-garde chiourme. « Computer Blue » et l’insensé « Darling Nikki » sont eux aussi le théâtre de cette lutte entre l’extravagance harmonique et instrumentale la plus folle et la rigueur rythmique la plus autoritaire. Sans la première, la seconde ne serait qu’une electro-pop-funky linéaire interminable et sans folie. Sans la seconde, la première donnerait lieu à un gigantesque loukoum imbouffable.
Sur Purple Rain, Prince est en permanence son propre fou et sa propre censure. Il se corsette et se libère lui-même à chaque seconde, conscient de ce que sa témérité pourrait gâcher. Affamé de musiques, de mélodies, d’instruments, d’arrangements, de détails, de références, tous plus complexes et riches les uns que les autres, il se raccroche à ses programmations rythmiques volontairement basiques, presque didactiques, comme on manie le coupe-coupe pour avancer dans la jungle.
C’est cette double tendance que je trouve particulièrement touchante sur cet album, lequel sert par ailleurs de bande-originale au film du même nom. Conformément à la musique que Prince lui a associée, Purple Rain est un film aussi grotesque (un long ego trip mégalomane totalement improbable) que troublant de sincérité (puisque Prince y met en scène son incommensurâââble génie autant que certaines autres facettes moins reluisantes). Il y raconte aussi l’histoire de la création de longue balade lacrymale à reverb « Purple Rain » par ses musiciennes Wendy & Lisa, jusqu’à son adoption tortueuse par le futur Nain Pourpre. Relégué en position finale sur l’album, où il dénote complètement, ce morceau agit comme une pièce rapportée. Cette position d’outsider à qui l’on consent finalement à laisser une place lui donne un aspect plus modeste, plus sympathique aussi, me le ferait presque aimer. Presque.
par Maxime Chamoux

 Follow
Follow