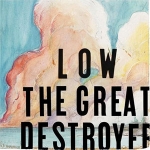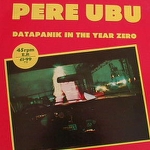maxime chamoux
CHRONIQUES : (PLEASE) DON'T BLAME MEXICO PRESENTE
LOU REED / « Coney Island Baby » (1975)

En 1975, Lou Reed n’est pas encore l’animal perfide qui terrorise les journalistes mal préparés en interview. Il est pire que ça. En 1975, Lou Reed est un déchet. Quelqu’un que plus personne n’ose toucher ni même approcher. Il est drogué, malade, sans le sou, poursuivi en justice par un ancien manager, traqué par les impôts qu’il n’a pas payé depuis cinq ans, quasi SDF, au fond du trou. Surtout, c’est sa santé mentale qui commence à inquiéter. Il vient de publier coup sur coup deux albums qui transcendent le concept d’échec commercial : Sally Can’t Dance, jugé transparent à sa sortie (mais qui mérite sa petite réévaluation aujourd’hui) et, surtout, l’heure de musique la plus pénible jamais couchée sur bande Metal Music Machine, sorte de vomi industriel avant l’heure au sujet duquel Reed dira d’ailleurs que « ceux qui l’ont acheté sont encore plus tarés que moi ». Le machin sera retiré des bacs trois semaines après sa sortie. En 1975, Lou Reed est un bon gros freak perdu pour l’Histoire.
Semble-t-il.
Son salut viendra d’un certain Ken Glancy. En 1975, Ken Glancy est le président du label RCA, qui héberge Lou Reed. C’est un businessman aguerri, certes, mais surtout un « homme d’honneur » comme le dira plus tard Reed, pourtant pas abonné aux compliments. Le président lui propose un deal : il lui offre un toit au Gramercy Park Hotel et lui finance intégralement l’enregistrement d’un nouvel album si Reed promet de ne pas faire « Son Of Metal Music Machine ». Plus que les impôts, plus que la mort, plus que le manque de drogue, plus que de devenir fou, le monde de Lou Reed est soudain plein d’une autre angoisse : trahir un homme qui lui a accordé sa confiance.
Un professeur de philo nous a dit un jour, lors d’un cours sur William et Henry James, que tous les grands auteurs américains étaient hantés par la notion de confiance. Comme n’importe quel grand auteur américain, Lou Reed a écrit avec « Coney Island Baby » une chanson sur ce thème – sur ce que ça signifie d’accorder sa confiance, de l’accepter, de l’honorer. « Coney Island Baby » est une chanson sur la gratuité, sur l’absolu au coeur de cette notion. On l’accorde ou on ne l’accorde pas, ça ne s’explique pas. Mais si on l’accorde, elle guide vos faits et gestes et elle accomplit des grandes choses en votre nom.
Sur un édredon blanc et bleu (basse ronde et chaude, guitare effleurée, batterie qui dort debout), un homme se souvient de ses années de lycée. L’entraîneur de l’équipe de football est un sale type, méchant, dictatorial. Mais ce tyran a un jour fait confiance au narrateur. Dorénavant, c’est décidé, ce dernier jouera au football « for the coach ». Quoiqu’il arrive. Passage en la mineur pour le refrain. Le narrateur se souvient de ceux qui lui ont accordé cette confiance, ce don gratuit. Cet amour. Comme cette princesse qui habite sur la colline qui l’a aimé alors qu’elle savait très bien qu’elle faisait une erreur. La beauté des personnes qui font ce don, et surtout, la beauté de ce qu’elles provoquent chez celui ou celle qui le reçoit, c’est la « gloire de l’amour » que chante Lou Reed, extatique, en fin de parcours. L’amour est performatif. Il fait faire des choses merveilleuses, il rend fort, il fait toucher la vérité sans cligner des yeux. Il fait écrire des chansons comme « Coney Island Baby ».
you gotta stand up straight unless you’re gonna fall
then you’re gone to die
And the straightest dude
I ever knew was standing right for me all the time
So I had to play football for the coach
and I wanted to play football for the coachWhen you’re all alone and lonely
in your midnight hour
And you find that your soul
it’s been up for sale
And you begin to think ’bout
all the things that you’ve done
And you begin to hate
just ’bout everything
But remember the princess who lived on the hill
Who loved you even though she knew you was wrong
And right now she just might come shining through
and the –
– Glory of love, glory of love
glory of love, just might come through
par Maxime Chamoux
CHRONIQUES : (PLEASE) DON'T BLAME MEXICO PRESENTE
PRINCE AND THE REVOLUTION / Purple Rain (1984)

Comme à Michael Jackson, autre mastodonte de la pop mainstream des années 80 – je ne me suis intéressé à Prince que très récemment. J’étais bourré d’a priori quant à cet artiste, je trouvais ses changements d’identités (The Artist, The Love Symbol) et ses accoutrements absolument ridicules, j’avais en tête l’omniprésente image du nabot pseudo-lover avec ses brushings de secrétaire médicale de province, et surtout je haïssais « Purple Rain », le morceau. Je n’avais donc jamais vraiment écouté Prince. Et puis un jour, un ami m’a fait écouter « When Doves Cry » en voiture – lieu souvent déterminant pour apprendre à aimer, ou non, un groupe ou un musicien, la voiture. Il m’a expliqué à quel point ce single, n°1 des charts américains en son temps, pendant plusieurs semaines devant le rival Michael Jackson, était révolutionnaire. En effet, il réussissait le tour de force d’être un morceau de danse implacable (il a dû traîner des millions de personnes sur le dancefloor depuis 1984) sans utiliser de basse ! Pour conduire le groove de son morceau, Prince ne se sert que de la programmation rythmique hyper-simpliste et du placement de sa voix. Un gimmick de synthé sur les refrains et le tour est joué.
Je me suis alors rendu compte d’à quel point les approches de Prince et Michael Jackson était opposées : Michael Jackson jouant sur la surenchère, l’empilement des arrangements, des voix, des couches de sons pour atteindre un paysage sonore saturé d’informations et compact ; Prince misant davantage sur les vides, les espaces entre les sons, adoptant une esthétique plus étirée – ne serait-ce qu’au niveau de la durée des morceaux. Pas un hasard si des gens aussi divers que Spoon, Mathieu Boogaerts ou les Neptunes, qui partagent ce même goût pour le groove dégraissé et la binarité simple, révèrent autant Prince.
(Please) Don’t Blame Mexico
Maxime, tu étais déjà dans Subjective en Mai 2009, avec ton autre groupe, Toy Fight…
Maxime Chamoux : Ah, avec Toy Fight, c’était un de nos meilleurs souvenirs d’interview. Interview très bien préparée… Je te mets bien la pression, là. (rires)
Oh la la…
Maxime : L’album n’était pas encore sorti, c’était une des premières interview un peu conséquentes qu’on avait à faire, donc c’était un bon entraînement. Et puis on avait vraiment aimé, parce que c’était dense, comme interview. On parlait vraiment de choses intéressantes.
(Please) Don’t Blame Mexico
Vous rentriez d’un lieu familier. Vous aviez encore votre cravate. Qu’est ce qui vous a pris, ce soir, de prendre un détour inconnu, de vous arrêter sur cette route déserte ? Est-ce la fatigue ou bien cette chanson des Smashing Pumpkins vissée dans votre tête, qui vous a fait entendre ces notes, étranges, festives ? Vous baissez la fenêtre. La folie mélodique des Smash est soudain prise dans les vapeurs d’octobre et d’opium. Vous croyez les voir, alanguis sur leurs citrouilles, oubliant de les pulvériser, ciselant leurs contours pendant des heures, au bord de leurs pupilles dilatées. Vous coupez le courant.
En vous approchant, vous distinguez trois musiciens. Ils disent s’appeler (Please) Don’t Blame Mexico. S’affairant à les changer en carosse, ce sont des chansons qu’ils tiennent entre les mains. Vous les interrompez dans leur recherche minutieuse : ils ne savent plus s’ils ont passé des heures ou des années à dessiner leurs lignes d’arrangements. Ils ne connaissent plus que le temps de la musique.