chroniques
CLUBE DA ESQUINA / Clube Da Esquina (1972)

L’album Clube Da Esquina est paru en 1972 sous la double égide de Lô Borges et Milton Nascimento mais il est l’œuvre d’une sorte de collectif réunissant quelques valeurs montantes de la musique Brésilienne de l’époque… S’y côtoient notamment le pianiste Wagner Tiso, le grand guitariste Nelson Angelo, le parolier Fernando Brant… On a affaire ici à une sorte de monument pop œcuménique, brassant folk, rock anglo-saxon, rythmes et chaloupes chipés au choro et à la samba, guitares psychédéliques héritées du tropicalisme, arrangements d’une musicalité irréprochable et mélodies éblouissantes.
Le plus étonnant étant que, bien loin de s’apparenter à une construction post-moderne qui fatigue les nerfs et le goût, Clube Da Esquina se trouve être un miracle d’équilibre et de souplesse, un radeau à la légèreté toute brésilienne, c’est-à-dire teintée d’une bonne couche de mélancolie buissonnière. Se déploient à nos oreilles ébahies une succession d’humeurs, de désirs, d’attentes, d’exaltations – trouées de lumière sur une mer particulièrement limpide et belle – , le tout révélant un filon inépuisable de couleurs tirées d’une palette jamais retrouvée depuis.
Par Mocke
VOIR LA PAGE DE MIDGET!
JIMMY GIUFFRE / Western Suite (1958)

Jimmy Giuffre était un clarinettiste texan issu d’un mouvement, le West Coast qui ne m’intéresse pas plus que cela mais vers la fin des années 50, il monte ce trio sans batterie avec Bob Brookmeyer (trombone) et Jim Hall(guitare), expérimentant une sorte de Jazz de Chambre, concept à peu près inédit à l’époque si l’on exclut les tentatives d’Ahmad Jamal et d’Edmund Hall. Ce qui me fascine dans Western Suite est qu’il parvient avec très peu de moyens à recréer une sorte de Texas imaginaire et fantasmatique évoquant à la fois Aaron Copeland ou la musique Old Time sans jamais s’en approcher autrement que par suggestions, non–dits, échos, sifflements lointains. Comparable si l’on veut à l’orient esquissé par Duke Ellington dans Far East Suite. Dans les deux cas, on a affaire à une matière impalpable, moins réalité géographique qu’étoffe des rêves. Les arabesques et entrelacs tracés par les trois comparses sont autant de collines mélancoliques, de prairies à l’étoile, d’horizons déclinant et de chants d’oiseaux à la nuit tombante.
Par Mocke
CHRONIQUES : WOLVES & MOONS PRESENTE
MILES DAVIS / Kind Of Blue (1959)

Inutile d’écouter le morceau suivant si la température baisse, si le vertige ne vous a pas encore fait trébucher dans les limbes, si vous pensez maîtriser l’espace qui vous entoure, ou encore pire, si vous n’êtes pas à ce point exténué, que vos obsessions vous dictent encore quoi faire. Il vous faut abandonner l’Homme, muer vers une personnalité que vous n’avez peut-être jamais connu, sans prétention, désapprendre, oublier et s’émerveiller.
Certains diraient, à juste titre, que ce monument d’album est le point influent de la musique dans la dernière moitié de siècle, tellement sa richesse, son bon sens, sa complexité et sa maitrise sont grandioses. D’autres, comme des rats, voudraient privatiser son écoute (cupides salopards avaricieux), pour concentrer le savoir et le pouvoir que renferment ces 45 minutes et 44 secondes de vertu. Enfin, à la limite, n’importe qui croirait, par vantardise, savoir expliquer, interpréter « So what ». Probablement inondé d’une connexion télépathique inédite avec le feeling du sextet, à la session précise de l’enregistrement, ce fameux 2 mars 1959 …
Finalement , ce que j’en dis : je vous conseille tout simplement de ne rien retenir de tout cela (et donc d’avoir lu ces lignes inutilement). Car oui, ce qui me fout les poils ne peux pas être dit, mais joué.
Par Louis Morati
CHRONIQUES : WOLVES & MOONS PRESENTE
BERT JANSCH

L’idée de pouvoir un jour rencontrer le bonhomme, musicalement et humainement, m’a poussé davantage à pratiquer l’instrument qui pour lui a été dès son plus jeune âge un vieil ami.
Un sens de la mélodie hors du commun, des doigts puissants et une attitude décontractée. Une guitare ne pouvait que rêver de tomber entre ces mains avant qu’il ne la repose encore vibrante d’émotion. Rosemary Lane, 1971 un album de vie (« Bird Song »), de mésaventures (« Nobody’s Bar »), de rêves (« A Dream, A Dream, A Dream »), d’amour (« Tell me what is true love ? « ), toutes des chansons qui je sais me feront toujours la même impression.
Une simplicité qu’il faut rappeler en ces temps de « beats » acharnés. Traditionnel, folk, blues, la plupart du temps inclassable, voila du génie dont le monde aurait pu profiter, mais encore trop tard pour l’homme en question.
Par A. Richard
» La suite !
CHRONIQUES : WOLVES & MOONS PRESENTE
KINGS OF CONVENIENCE

Deux guitares sèches, deux voix, deux copains, d’autres copains pour les accompagner des fois…
Leur musique parle du temps, d’amour, de la nature, d’évasion. Ils nous racontent de jolies petites histoires, mélangeant leurs douces voix a la perfection sur des airs de Bossa Folk Bio.
C’est frais, ça sent le soleil et la pluie, ça fait voyager loin, ouf !
Par Maxime
CHRONIQUES : YOUR HAPPY END PRESENTE
Q-TIP / The Renaissance (2008)

Mr. Q-Tip de A Tribe Called Quest de retour pour un album solo très attendu. Vous savez, c’est cette petite voix groovy nasillarde sur le génial « Galvanize » des Chemical Brothers ? Étant fan de ATCQ, je trouve que cet album donne un bon coup de frais dans les sorties hip hop mainstream bas de gamme comme il y en a tant maintenant. Un album orienté hip hop 90’s (époque ATCQ – The Low End Theory) avec Q-Tip lui-même quasi partout aux manettes (sauf l’excellent « Move » produit par le regretté Jay Dee mis à titre posthume), très épuré et efficace. On retrouve ce flow de Q-Tip, si atypique ; qui coule sur toutes les instrus, sans problème, à l’ancienne. A écouter au soleil, notamment le titre « Gettin’ Up » avec son instru si groovy que j’en ai encore la chair de poule !
par Guillaume Zolnierowski
CHRONIQUES : (PLEASE) DON'T BLAME MEXICO PRESENTE
LOW / The Great Destroyer (2005)
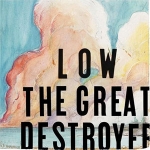
Il est de ces disques où le producteur sublime l’artiste. Bien qu’éculée, cette phrase prend ici tout son sens.
Jusque là, Low était connu pour ses douces balades, ses comptines introverties pour adulte mélancolique. Ces tristes chansons lentes et langoureuses qui s’effacent au loin dans le blizzard des alentours de Duluth, Minnesota, ville dont sont originaires Alan Sparhawk et Mimi Parker, couple fondateur du groupe. Le groupe avait peaufiné son style au fil des années, précisé son écriture minimaliste, fait de la sobriété son cheval de bataille, aux côtés de producteurs comme Steve Albini.
Seulement, au milieu des années 2000, Low décide de travailler avec Dave Fridmann. Ils trouvent alors une personne qui comprend et mène à bien leurs nouvelles aspirations. Qu’aurait été The Great Destroyer sans la contribution de Fridmann ? Une répétition du raté Trust, album précédent où les envies se font sentir mais dont on ne comprend le véritable propos qu’à l’écoute de son successeur ?
Pour la première fois, le groupe laisse éclater avec grâce et pertinence la violence sous-jacente de sa musique, la hargne qu’insinue son songwriting. The Great Destroyer bouillonne là où les albums précédents marchaient dans la neige. Et la production est la première ambassadrice de ce virement de bord : sur des chansons à l’abord plutôt froid, Fridmann apporte la chaleur des machines analogiques poussées à l’extrême. Les gains sont tournés au maximum, les compresseurs marchent à plein régime et chaque son en ressort avec un grain unique. Saturés, distordus, les instruments se retrouvent embarqués dans la salle des machines d’un brise-glace lancé à toute vapeur (il n’y a qu’à écouter l’intro de « Monkey », première chanson de l’ album, pour s’en rendre compte). Le groupe se découvre un penchant Noise où les larsens se font plus tranchants que jamais. Les doux tambours de Mimi Parker deviennent une véritable batterie abrasive (la chanson « The Great Destroyer »).
Ceci résulte en un album âpre et granuleux, aux compositions plus virulentes, voire vindicatrices (« Everyday they torture us, they torture us and say : nothing stays together. Breaking everybody’s heart, taking everyone appart » sur « Everybody’ s Song »). Et là où l’on avait l’habitude d’entendre Low utiliser le silence et les espaces vides, on se fait surprendre par l’ampleur sonore, on se fait réveiller par le souffle et les crachotements des amplis à lampes allumés depuis des heures.
Ce disque, et surtout cette production, aurait pu faire école tant ils repoussent les limites du « beau » son. Jamais rien n’a autant grouillé et râpé en même temps, et cela, tout en laissant la beauté s’échapper des mélodies limpides du trio. Car la force du groupe est toujours là : ses mélodies, ses harmonies à tomber par-dessus le bastingage, ses prises d’otage de nos cœurs sont tout simplement propulsées à l’étage supérieur. L’impact n’en est que plus sidérant. (Et certains ne s’y sont pas trompés, puisque le festival Primavera Sound de Barcelone, grand messe indé européenne, a programmé cette année une performance exceptionnelle du groupe jouant The Great Destroyer dans son intégralité.)
Dans sa dynamique de remise en question, Low s’interroge non seulement sur sa musique, mais également sur la musique en tant que nécessité pour un musicien (« Death Of A Salesman ») et ses conséquences (« When I Go Deaf »). Une chose est certaine après cela : les bourdonnements et autres acouphènes seront à jamais mélodieux et emplis d’humanité.
par Thomas Pirot































