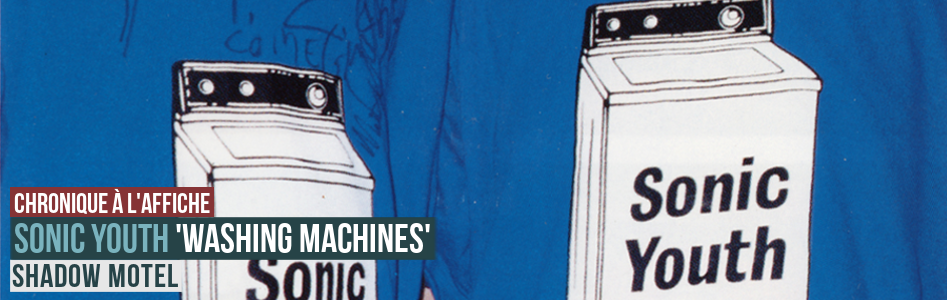CHRONIQUES : MOLOKO VELOCET PRESENTE
LOU REED / Transformer (1972)

Lou Reed claque les portes du Velvet Undeground juste avant le mixage de Loaded. Son premier album solo arrive dans la foulée, composé de vieilles chansons écrites à l’époque du Velvet, et à la production vaguement rock pour marquer le coup. Echec. Lou sombre. (Lou ride.)
Et puis Bowie qui, à cette époque, s’évertue à sauver le rock (on le voit aussi avec Iggy Pop) vient frapper à la porte de Reed. Ils tracent de ‘grandes lignes’ vers l’avenir et lui promet de renouer avec le succès.
Et voilà ce bon vieux Lou qui troque son rôle de poète rock maudit contre celui de dandy glam-rock. Et ça marche : sans délaisser ses thèmes favoris (drogues, faubourgs mal famés, sexe déviant et amérique en déclin) il nous propose ici un véritable cabaret rock avec ses personnages tragi-comiques à foison.
Moloko Velocet a choisi pour vous de revisiter quelques titres de cet album intemporel (ce soir à l’Aéronef, ndlr). A la manière de Lou Reed : avec ce qu’il a sous la main, et le son a fond si possible.
par Pierre Batleff
CHRONIQUES : LA FELINE PRESENTE
LOU REED / « Kicks » (1975)

La pose et la voix qui tremble
Longtemps je n’ai pas trop aimé Lou Reed. Je ne parle pas de la silhouette flétrie qu’il est devenu, à mi-chemin entre la momie et l’insecte. Je parle du Lou Reed de toujours, celui du Velvet et de l’album Berlin, de ces photos noir et blanc contrastées à bloc, devenues des modèles d’élégance arty ; du Lou Reed à qui Lester Bangs était prêt à faire des tas de cochonneries en échange d’une toute petite interview. C’est cette image de légende, si parfaite et codifiée, qui m’a longtemps retenue de l’écouter vraiment : lunettes noires vissées sur un visage de statue romaine, l’absence de sourire gravée dans le marbre, l’air supérieur et blasé, le tough & skinny guy fascinait trop pour me toucher. Alors même que Lou Reed est un des types les plus lettrés de l’histoire du rock, qui a écrit des textes d’une profondeur inouïe, alors même que son répertoire fourmille de chansons déchirantes, que son histoire est déchirante – la séance d’électrochocs à treize ans – c’est toujours à lui que je pense quand je me rappelle ce fait qui n’a rien d’un scoop : dans le rock, l’attitude est plus importante que les chansons. Son attitude était tellement forte, tellement arrogante, qu’elle a été cent fois reprise, jusqu’à confiner à la pose. Une façon d’être qui s’est figée et qui ne dit plus vraiment qu’on est un rebelle, mais que c’est sexy d’être rebelle ; loin de toute fragilité, de tout faux pas, on y puise une façon de se fringuer et de toiser le photographe, qui confère à n’importe qui une panoplie de mec « cool » aisément identifiable. Je reconnais que l’image est belle, fascinante, et elle fut sans doute parfaitement juste pour incarner ce que Reed avait à incarner. Mais pour tout un tas de raisons confuses, je lui préfère celle de Cale, moins maîtrisée, plus incertaine.
Ce que j’aime en revanche chez Lou Reed, c’est sa voix. Nasillarde, hautaine, un brin monocorde, elle ressemble bien à l’image évoquée plus haut. Seulement voilà, quand il chante, Lou a la voix qui tremble. Séquelle d’électrochocs et de speed, ou regain de pathos incontrôlé ? Elle me bouleverse sur « Perfect Day », « Lady Day » ou « Sword Of Damoclès », cette chanson tardive (sur l’album Magic and Loss, 1991), composée pour son ami Doc Pomus, alors en phase terminale. Mais c’est dans le morceau « Kicks » (Coney Island Baby, 1975) que je l’ai entendu me livrer sa leçon la plus nihiliste, précisément à propos de la pose. « Hey man what’s your style ? », répète la voix qui circule de long en large dans une pièce enfumée, remplie de gens qui se la donnent en buvant du whisky et en revenant des toilettes le nez irrité. On les entend qui gueulent un peu, mais déjà loin, très loin, sur le lit d’un riff de guitare bluesy moite, répété en boucle comme sur un disque rayé que les gars sont trop défoncés pour aller changer de face. Un jeu de cymbales omniprésent fait chorus avec les fréquences de voix dans un nuage sonore gris électrique. Dans cette fumée qui pique la peau, la voix de Reed redemande : « Hey man what’s your style ? / How you get your kicks for living? ». Le ton est blasé, c’est l’ennui. Mais un événement a émoustillé la faune avachie qui se tient là dans le vague espoir de trouver un motif d’excitation. On en parle dans les journaux : un mec en a tué un autre, apparemment, d’un coup de couteau, on a vu couler du sang. « When the blood comma’ down his neck…/ Don’t you know it was better than sex, now, now, now / It was way better than getting mean / ’cause it was, the final thing to do, now / Get somebody to come on to you […] And then you kill ’em, yeah / You kill ’em, now, now, cause I need kicks » Kicks: le pied ! Mieux que tout ce que promet le rock’n’roll, en somme : quelque chose de vraiment excitant, de vraiment réel. Mieux que la plus radicale, la plus méchante des attitudes. « Hey man what’s your style ? » : la question reste sans réponse, c’est le monologue d’un esthète déguisé en voyou, l’ode au meurtrier d’un snob en manque de vérité, de vrai chair, d’adrénaline et de sang. Et la voix monocorde se met à bégayer de plus belle, comme pour dominer son habituel tremblement : « I need, need, need, need, need, need, need some kicks / Yeah, need, need, need, need, need, need, need some kicks / Oh, give it now, kicks / Yeah, need some kicks / Yeah, need some k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k, kicks. » Et en trois phrases, j’entends tout : l’ennui, la morgue et l’impuissance. La sacro-sainte attitude qui se retourne en incantation enragée et en désespoir. Cette fois, Lou, je te crois.
par Agnès Gayraud
CHRONIQUES : (PLEASE) DON'T BLAME MEXICO PRESENTE
LOU REED / « Coney Island Baby » (1975)

En 1975, Lou Reed n’est pas encore l’animal perfide qui terrorise les journalistes mal préparés en interview. Il est pire que ça. En 1975, Lou Reed est un déchet. Quelqu’un que plus personne n’ose toucher ni même approcher. Il est drogué, malade, sans le sou, poursuivi en justice par un ancien manager, traqué par les impôts qu’il n’a pas payé depuis cinq ans, quasi SDF, au fond du trou. Surtout, c’est sa santé mentale qui commence à inquiéter. Il vient de publier coup sur coup deux albums qui transcendent le concept d’échec commercial : Sally Can’t Dance, jugé transparent à sa sortie (mais qui mérite sa petite réévaluation aujourd’hui) et, surtout, l’heure de musique la plus pénible jamais couchée sur bande Metal Music Machine, sorte de vomi industriel avant l’heure au sujet duquel Reed dira d’ailleurs que « ceux qui l’ont acheté sont encore plus tarés que moi ». Le machin sera retiré des bacs trois semaines après sa sortie. En 1975, Lou Reed est un bon gros freak perdu pour l’Histoire.
Semble-t-il.
Son salut viendra d’un certain Ken Glancy. En 1975, Ken Glancy est le président du label RCA, qui héberge Lou Reed. C’est un businessman aguerri, certes, mais surtout un « homme d’honneur » comme le dira plus tard Reed, pourtant pas abonné aux compliments. Le président lui propose un deal : il lui offre un toit au Gramercy Park Hotel et lui finance intégralement l’enregistrement d’un nouvel album si Reed promet de ne pas faire « Son Of Metal Music Machine ». Plus que les impôts, plus que la mort, plus que le manque de drogue, plus que de devenir fou, le monde de Lou Reed est soudain plein d’une autre angoisse : trahir un homme qui lui a accordé sa confiance.
Un professeur de philo nous a dit un jour, lors d’un cours sur William et Henry James, que tous les grands auteurs américains étaient hantés par la notion de confiance. Comme n’importe quel grand auteur américain, Lou Reed a écrit avec « Coney Island Baby » une chanson sur ce thème – sur ce que ça signifie d’accorder sa confiance, de l’accepter, de l’honorer. « Coney Island Baby » est une chanson sur la gratuité, sur l’absolu au coeur de cette notion. On l’accorde ou on ne l’accorde pas, ça ne s’explique pas. Mais si on l’accorde, elle guide vos faits et gestes et elle accomplit des grandes choses en votre nom.
Sur un édredon blanc et bleu (basse ronde et chaude, guitare effleurée, batterie qui dort debout), un homme se souvient de ses années de lycée. L’entraîneur de l’équipe de football est un sale type, méchant, dictatorial. Mais ce tyran a un jour fait confiance au narrateur. Dorénavant, c’est décidé, ce dernier jouera au football « for the coach ». Quoiqu’il arrive. Passage en la mineur pour le refrain. Le narrateur se souvient de ceux qui lui ont accordé cette confiance, ce don gratuit. Cet amour. Comme cette princesse qui habite sur la colline qui l’a aimé alors qu’elle savait très bien qu’elle faisait une erreur. La beauté des personnes qui font ce don, et surtout, la beauté de ce qu’elles provoquent chez celui ou celle qui le reçoit, c’est la « gloire de l’amour » que chante Lou Reed, extatique, en fin de parcours. L’amour est performatif. Il fait faire des choses merveilleuses, il rend fort, il fait toucher la vérité sans cligner des yeux. Il fait écrire des chansons comme « Coney Island Baby ».
you gotta stand up straight unless you’re gonna fall
then you’re gone to die
And the straightest dude
I ever knew was standing right for me all the time
So I had to play football for the coach
and I wanted to play football for the coachWhen you’re all alone and lonely
in your midnight hour
And you find that your soul
it’s been up for sale
And you begin to think ’bout
all the things that you’ve done
And you begin to hate
just ’bout everything
But remember the princess who lived on the hill
Who loved you even though she knew you was wrong
And right now she just might come shining through
and the –
– Glory of love, glory of love
glory of love, just might come through
par Maxime Chamoux
CHRONIQUES : LA FELINE PRESENTE
APPARAT / « Live @ Fad, Barcelona » (2003)

En bon synthé-man de La Féline, je voue une passion aux nappes synthétiques. Première époque, enfance, les cités d’or présentent une OST synthétique superbe, immersive, et toute en textures synthés old school planantes. Déjà amoureux de Zia, je suis d’autant plus captivé par ces sons magiques. Deuxième époque, la voiture d’un copain, Houlgate by night, et “Wish you Were Here” de Pink Floyd dans l’autoradio. Là encore, des nappes synthétiques irréelles, splendides, l’immersion est totale. La rencontre était évidente.
A cette époque je me demandais régulièrement pourquoi aucun groupe moderne ne reproduisait les sons de Pink FLoyd ? Aujourd’hui je sais que c’était un désir stupide, et par exemple je fuis toute chronique de Magic qui va encore encenser le dernier popeux venu aux Beach Boys.
Troisième époque, Internet, les forums de musique, j’ai découvert Apparat, dont les textures de nappes, encore elles, m’ont immédiatement touchées. Apparat n’atteint pas toujours des sommets, mais quand il les atteint, ce sont des Everests. Ce live en est un. ll n’est pas totalement exempt des tics de production de son époque, mais qu’est-ce que j’aurais aimé y être ! J’aime spécialement Apparat car sa production est toujours tournée vers le futur, les sons sont technologiques, futuristes, sa musique ne paie pas de tribut particulier au passé, point de tentation vintage. Alors, dans mon panthéon 2000 il trône aux côté de Timbaland, Animal Collective et quelques autres qui ont amené une couleur inexistante jusque-là, loin — au-dessus, en fait — des revivalists.
Si les cités d’or doivent revivre un jour, c’est à lui qu’il faut confier la bande-son.
Télécharger ici.
Apparat a donné ce mp3 en téléchargement libre sur son site durant plusieurs années, alors je suppose que je peux faire de même.
par Xavier Thiry
CHRONIQUES : MICHAEL WOOKEY PRESENTE
THE VELVET UNDERGROUND / The Velvet Underground (1969)

C’est l’album avec les chansons “Jesus”, “Candy Says”, “Pale Blue Eyes”, “After Hours”. Les deux premiers albums du Velvet Underground étaient brouillon (dans un sens positif), avant-garde et très noisy. Ce troisième album était une réelle surprise, parce que c’était un changement complet de direction. Le mythe veut qu’on leur ait volé toutes leurs pédales d’effets à l’aéroport et qu’ils aient été contraints de faire un album minimaliste. De toute évidence, je n’étais pas né à l’époque et j’ai découvert tous leurs albums à peu près en même temps. Il m’a fallu du temps pour appréhender le fait qu’ils aient pu sortir les deux premiers albums qui étaient si bizarres, puis celui-ci qui revêtait un aspect beaucoup plus léger.
par Michael Wookey
Clip : “Transistors” par Isaac Delusion
Tourné entre la Normandie et les années 50, le clip de « Transistors » fait suite à l’excellent accueil qu’a reçu leur Early Morning EP, et vient déjà de faire l’objet d’une chronique par le fameux magazine US The Fader.
» La suite !
Subjective Live! #13 : jeudi 6 décembre à l’International
“Love hurts, love scars, love wounds, and mars” (Roy Orbison)
Lunettes noires et crooneries obligatoires, pour cette soirée qui est à inscrire en bonus dans votre calendrier de l’Avent fin du monde. Si vous n’avez pas encore fini votre abri antiatomique, la cave de l’International vous sera (au moins pour cette nuit) grande ouverte !
Subjective vous propose trois Saint Nicolas (orbinsoniens) pour cette soirée placée sous le signe de la communion hédonique et chocolatée.
Quand ? Jeudi 6 décembre, 20h.
Où ? A l’International (Paris 11)
Combien ? C’est gratuit.
Facebook ? Oui !

En première partie : MOTION OF HIPS.
Tout en nuances, Motion of Hips s’empareront insidieusement de vos sens pour ne plus les lâcher avec leur pop/rock colorée, à la grâce et au raffinement inspirés.
« Motion Of Hips ou l’assurance de remuer les hanches à l’écoute de mélodies pop-rock gracieuses et progressives. Plus que de simples morceaux on distingue des aquarelles avivées de touches de Radiohead et de de teintes de Phoenix. Le trio parisien triomphe par les nuances et l’éclat d’une production raffinée. » (Les Inrocks)
En deuxième partie : PERSIAN RABBIT.
Supergroupe, alliance démoniaque de la scène lilloise, les Persian Rabbit mordent, caressent et jouent (sans être masochistes) une musique très addictive, sombre et puissante, grâce à un instrumentarium diabolique.
« En plus de ses trouvailles mélodiques, l’intérêt de Persian Rabbit provient de sa palette instrumentale, qui comprend notamment une contrebasse et un harmonium. La batterie acoustique adopte des sonorités ténébreuses, de celles qu’on entend souvent sur les productions du label Constellation. L’harmonium possède une forte puissance émotionnelle et exploite un registre déjà creusé par les albums de Nico. » (Magic)
En troisième partie : MOTORIFIK.
Lancés à toute berzingue depuis Manchester, Motorifik vous propulseront vers l’infini et le raffinement d’une powerpop appelant les ombres bienveillantes de Phil Spector, d’Alan McGee et des versaillais Air.
« If psych-pop duo Motorifik had been around in the 1990s, they would probably have been on Creation Records, so perfectly do they embody that aesthetic, with churning slo-mo guitar grooves and great, anthemic choruses hovering on the edge of legibility. » (The Independent)
DJ set : HARTZINE.
DJ set Hartzine à 120 BPM, pas moins.