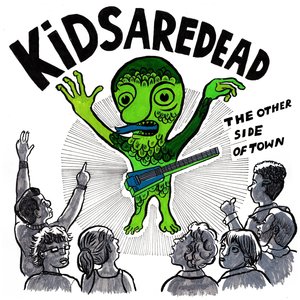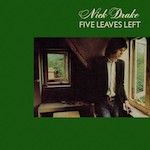SUBJECTIVE PRESENTE
SHADOW MOTEL
Discogs.com propose à ce jour les notices de 5 423 714 disques différents (dont Ausfahrt Nach de Shadow motel – 11 euros à l’argus). Si vous vous limitez à une chanson pour chacun des 3 627 944 artistes recensés, un peu moins de 200 titres par jour pendant 50 ans vous suffiront pour écouter à peu près toute la musique sortie avant 2015. Facile. Voilà en gros l’étendue du brouhaha que nous propose la pop. Mais ce serait dommage de n’écouter qu’une seule chanson de Shadow Motel en 50 ans. Pour ceux qui commenceraient déjà leur playlist d’un demi siècle, placez y tout de même « Jim », « Applause », ou « Ivory Eyes ». Du brouhaha de quelques millions de titres il est tout de même permis d’espérer que certains pourront se démarquer, émerger un peu de la masse.
 Ausfahrt Nach, disponible via Discogs
Ausfahrt Nach, disponible via Discogs
Quand j’étais ado, un groupe légendaire de rock expérimental new-yorkais avait une place de choix parmi les photos d’artistes que je punaisais alors sur le mur de ma chambre. Ils avaient leur « son », comme disent les amateurs de bon « son » : harmonies uniques, fureur et atonalité, étrangeté, audace… Tout ça empaqueté dans du rock’n’roll. Pas mal. Cette année j’ai eu l’occasion de voir le projet solo du « poète » du groupe légendaire de rock expérimental new-yorkais. Au milieu du concert, il nous a expliqué que la prochaine chanson avait été inspirée par ses vacances à Lecce. Au stand merchandising, ou l’on trouvait des rééditions des disques des années 1980 du groupe légendaire, je me rendis compte que le « poète » et son batteur étaient bien sympathiques mais avaient tout de même l’âge de mes parents. Mais en première partie du groupe légendaire, il y avait Shadow Motel qui proposait sa formule, son intuition à renouveler un genre que le groupe légendaire de rock expérimental new-yorkais avait largement popularisé. Ouvrant pour des pages vivantes d’histoire du rock, le groupe pouvait compter sur les quelques grammes de magie qu’ils parviennent toujours à insuffler dans chacun de leurs morceaux. Le trio tient une formule, qu’ils appliquent avec plaisir. Une tactique née de tâtonnements occultes qu’ils semblent bien aise d’avoir découverte.
Nicolas Paugam : passage souterrain
Une chronique dithyrambique de l’Aqua Mostlae débute sur une interrogation à la Pierre Vassiliu : « Qui c’est celui-là » ? Nicolas Paugam traficote une drôle de musique : elle nous a d’abord laissés sceptiques puis pantois. Tropicaliste pour les influences brésiliennes qui caractérisent la structure de ses morceaux, manouche pour la construction des soli ou de certains arrangements, et définitivement « chanson française » pour les textes et les thèmes abordés avec un surréalisme déconcertant, sa musique est aussi riche qu’inclassable. Et pour épaissir le mystère, cette affaire n’est pas récente : bientôt dix ans que Nicolas Paugam accumule les pépites sans faire trop de vagues. Dommage qu’il reste dans l’ombre et ne puisse pas jouir de la réputation qu’il mérite.
Robbing Millions : sur le bout des doigts
J’ai toujours eu un penchant pour les groupes où l’on sent que les musiciens ont une maîtrise de leur instrument et qu’ils la restituent à leur public avec justesse et parcimonie. Je n’aime pas la virtuosité quand elle n’est qu’un moyen décharné d’empiler les notes, je la préfère quand elle se fait le véhicule de structures et de couleurs musicales originales et innovantes. En bref, la forme au service du fond, et non l’inverse. Car je crois que dans mon esprit, il existe une limite assez claire entre les musiques techniques démonstratives où les partitions sont au service de la dextérité des doigts des musiciens et celles où la technicité des morceaux n’est qu’un élément parmi tant d’autres, un champ de possibilités permettant de désosser les structures pop jouées à l’avance, de creuser vers des sonorités parfois dissonantes.
Ce sont sur ces principes que surfent les cinq de Robbing Millions. A l’écoute de leur premier EP, Ages and Sun, la première chose qui m’a sauté aux yeux, c’était justement la prouesse technique qui se cache derrière des morceaux efficaces, en apparence pop. Quand on met Ages and Sun dans le lecteur et qu’on lance le premier titre, « Tenshihan », le gimmick de guitare met de suite les pendules à l’heure. C’est peut-être une influence des radios belges, telle que Classic 21. En France, pour entendre un morceau de Led Zep ou de Ten Years After, il faut trouver le bon canal, la perle rare. Mais je m’égare, et les choix éditoriaux des radios n’ont sûrement rien à voir là-dedans. Toujours est-il qu’à mon avis, Robbing Millions fait partie de ces groupes qui réintroduisent la virtuosité dans le rock, et d’autant plus dans le rock indé. Car mis à part un panthéon de rock stars sur-médiatisées, les groupes qui en font des caisses en la matière ne sont pas toujours les plus appréciés : les soli trop étirés sont parfois perçus comme des objets musicaux que seul un petit groupe de geeks apprécie, ravis de s’ébahir devant la mobilité des doigts de leurs starlettes. C’est peut être l’époque d’un changement. Le retour des virtuoses, qui se mélangent désormais aux paysages complexes des musiques actuelles, où coexistent musiques sans solo, soli radiophoniques chronométrés et soli d’improvisation.
On peut lire dans les blogs spécialisés que Lucien Fraipont, guitariste et grand manitou de Robbing Millions, est aussi un as du jazz, officiant dans de nombreuses formations de la capitale belge tel que Winchovski. La filiation se trouve donc aussi dans le jazz, et on est pas surpris d’entendre des partitions de guitares où le poids de chacune des notes est géré au millimètre. Pourtant, les Robbing Millions sont bien loin d’une filiation trop évidente avec certains genres, certains classiques. Ils semblent avoir digéré une flopée d’influences variées qu’ils assemblent au gré de leurs envies pour construire ce qui m’est apparu somme toute comme un ovni de la scène rock indé. Les registres abordés sont innombrables, on y trouve une pincée de folk, une once de jazz, un zeste de transe ; bref, un gloubi-boulga à la recette complexe. Mais j’ai l’impression que pour eux, le nerf de la guerre, c’est le trip. Poussez à fond votre ampli et enfoncez deux fois la touche « skip » pour arriver au troisième morceau, celui qui porte le nom de l’EP, « Ages and Sun ». L’intention est assez claire : faire planer. Psychédélique, le mot est lâché. Les voix jumelles se superposent, la basse danse là où on ne l’attend pas, les nappes de clavier apaisent le mouvement… On s’embarque en deux mesures dans leur univers et on oublie finalement assez rapidement que ces cinq fantastiques connaissent leurs gammes sur le bout des doigts.
Par Nicolas Fait
Crédit photo : Marine Dricot
Marc Desse : Nuit Noire
« Tout recommencer à zéro, tout recommencer à zéro… » J’ai entendu cette chanson de Granville un jour dans ma cuisine. Elle passait sur France Inter, la radio qui permet aux fonctionnaires de rester dans le coup et de deviser à la cantine sur Florence and the Machine et Anna Calvi. Grâce cette programmation, prompte à défendre le service public, je commençais bien ma journée, assez content d’entendre de la pop plaisante et chantée en français, passée aux heures de grande écoute, car quand toute votre vie, c’est avec les radios belges que vous avez fui le désespoir des ondes françaises, il est toujours étonnant d’y entendre ce qui se rapproche d’une bonne chanson.
Les mentalités évoluent et le bon goût est entré dans les chaumières un peu en même temps que l’ADSL. Les Mustangs, La Femme et Aline remplissent les salles et les festivals, les Fauves et les Feu! Chatterton font déjà de même… Demain bien d’autres suivront et c’est plutôt réjouissant au fond. Oui, ça chante en français, de plus en plus et dans tous les genres de la pop. « Tout recommencer à zéro », quel beau programme tout de même… Ces jeunes gens vont certainement tout mettre à plat et c’est bien, c’est prometteur. Fini le passéisme, la musique à papa et les disques à papa jamais dépassés. Sauf que les paroles, c’est « tout recommencer à Jersey » et j’ai été un peu déçu en l’apprenant. Se promener aux îles anglo-normandes, faire de la planche à Biarritz, penser aux copains ou regarder le ciel, ça ne révolutionne quand même pas le monde. En tout cas c’est toujours rafraîchissant. Ça tombe bien l’été commence.
Marc Desse, notre nouvelle obsession, sort au mois de juin un disque hivernal, aux chansons solitaires. Il a organisé récemment un festival rassemblant de l’autre côté du périph’ ce qui pourrait ressembler à la dream team de la nouvelle pop française. Lui, on le décrit comme un peu à part, détonnant parmi ces nouveaux jeunes gens modernes. C’est aussi notre avis. C’est d’ailleurs en cherchant des chansons de Jean Néplin – Rita Mitsouko maudit et jeune homme plutôt détonnant (les algorithmes font décidément bien les choses) – que je suis tombé sur la chaîne youtube de Marc Desse. Que des hits: « Petite Anne », « Des gens honnêtes », « Mona et moi » ou « Vidéoclub »: pour moi l’affaire était entendue. Desse, c’était un esthète, un type qui connaissait ses classiques par cœur et qui avait exploré à fond le moindre recoin du meilleur de l’electro-pop des années 1980. J’avais tout de suite aimé ses chansons limpides, équilibrant guitares aigrelettes et synthés rétros. Une voix douce et profonde, qu’il avait le bon goût de marier parfois à un chant féminin, évoquant les délicieuses chansons d’Elli et Jacno, lui donnait juste ce qu’il faut de charme et de mystère pour emballer, peser et expédier le tout. En tant que fan de pop en français j’avais ma dose, et je trouvais qu’il remplissait largement le cahier des charges du bon artiste émergent.
GRINDI MANBERG
Lumberton est une petite ville de Robeson County en Caroline du Nord, semblable à des milliers de petites villes américaines. Downtown, les distractions sont rares : les connaisseurs pourront éventuellement visiter la maison natale de l’actrice pornographique Carmen Hart, et les inconditionnels de l’American Football pousser jusqu’au domicile des parents de Vonta Leach, le fameux fullback des Baltimore Ravens. Aux alentours, les rapides de la Lumber River séduiront les adeptes du canoë, tandis que les passionnés d’ethnographie amérindienne se délecteront d’une promenade en territoire Lumbee dans les forêts avoisinantes. Mais pour le touriste standard, rien ne justifie un détour ou un séjour prolongé : la Lumberton réelle est une communauté résidentielle sans surprise, dont les attraits ordinaires sont vite épuisés.
La Lumberton rêvée par David Lynch est autrement plus mystérieuse. « She wore blue… ue… velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light… ». Rose rouge contre barrière blanche, sur fond de ciel bleu. Un pompier sorti des playmobil agite la main en souriant, perché sur le marchepied de son camion. Des petits enfants traversent la rue en sautillant pendant qu’un retraité arrose son parterre de tulipes jaunes. Images radieuses de l’Amérique éternelle. Cartes postales d’insouciance. Soudain, le tuyau d’arrosage se coince dans un arbuste et la mécanique de l’autosuggestion se dérègle. Le retraité se tord de douleur. Il s’effondre en se tenant le côté de la tête. La caméra s’enfonce dans les herbes, dans la terre : entourée par la masse grouillante des décomposeurs, git une oreille déchiquetée. Dans les petites villes américaines comme Lumberton, le trompe-l’œil est un cache névrose ; il suffit de déplacer le miroir dans lequel la classe moyenne arrange son maquillage pour révéler les foyers de perversions, de violences et d’inquiétudes qui l’ont depuis longtemps infectée. Dorothy Vallens est le symbole de toutes les victimes cachées de l’American psycho. Le rôle est joué par Isabella Rossellini, la fille d’Ingrid Bergman. Ingrid Bergman… Grindi Manberg.
Fantasized Lumberton est le premier EP de Grindi Manberg. Un EP qu’apprécierait sûrement d’écouter Lynch et qui ne dénoterait pas dans la bande originale de son prochain film, à côté des mélodies Badalamentiennes de rigueur. Pour la description objective de son style « electro-new wave », consultez la presse spécialisée. On n’évoquera ici ni les « synthés entêtants » ni les « guitares saturées aux accents psychédéliques ». Ces resucées d’adjectifs qui lassent les lecteurs et les artistes ont fini par ne plus plaire qu’aux chroniqueurs eux-mêmes qui s’écoutent parler de la musique.
Un autre morceau que j’aime bien : « Marine has the key ». Le dernier morceau de l’EP. Comme une réponse à l’énigme de la porte au début : on a retrouvé la clef mais elle est possédée par quelqu’un d’autre, qui ne la rendra pas. C’est la plainte d’un homme accablé par le sentiment de l’irrémédiable. Il faudrait l’écouter en lisant par exemple La chute de la Maison Usher, de Poe : « Pendant toute une journée d’automne, journée fuligineuse, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel, j’avais traversé seul et à cheval une étendue de pays singulièrement lugubre, et, enfin, comme les ombres du soir approchaient, je me trouvai en vue de la mélancolique Maison Usher ». On retrouve les mêmes paysages hantés par les souvenirs fêlés, la fatalité pour seule compagnie fiable du héros solitaire.
L’étrange texture musicale de Grindi Manberg, à double fond, à double face, donne envie d’y déposer des histoires. Un matin, la danseuse érotique Carmen Hart serait retrouvée noyée dans les eaux de la Lumber River. Les soupçons se porteraient sur son petit ami, le footballeur Vonta Leach, mais le détective en charge de l’enquête, connu pour ses méthodes peu orthodoxes, l’innocenterait après avoir pratiqué un vieux rituel des Indiens Lumbee. Un nommé Robeson lui apparaitrait en rêve… Robeson comme le County ? Ou plutôt Robertson… Bob ? Attendez, cette histoire existe : c’est Twin Peaks !
Kidsaredead : sur la colline
Par Agnès Gayraud aka La Féline
J’ai vu Kidsaredead aux Trois Baudets le 4 mars dernier. Nous étions une quarantaine de personnes, tous sagement assis sur les confortables banquettes rouges en contrebas de la scène où Vincent à la guitare et au chant, Cristián à la batterie et Mabit à la basse nous dominaient, en jouant plus fort et plus intense qu’on ne s’y sent habituellement autorisé dans l’écrin cosy de ce lieu. Et nous étions quarante – quelques sièges vides devant moi – à ne pouvoir s’empêcher de bouger la tête, les pieds, les genoux. Ça faisait vibrer toute la rangée des sièges. Il fallait faire gaffe, à tout moment l’ondulation pouvait prendre de l’amplitude. C’était presque un peu gênant pour ceux du bout qui jetaient des regards réprobateurs en direction des plus agités du centre. Et comme les rythmes de Kidsaredead ne sont pas des rythmes simples, et qu’ils changent souvent, chacun avait un peu son petit groove à lui : ça faisait des tensions contraires sur l’armature des fauteuils, d’avant en arrière, de droite et de gauche, et ça grinçait un peu. Il fallait se contrôler du coup, entre gens civilisés, écouter surtout avec les oreilles, et opter pour un pogo essentiellement intérieur.
À la vérité, nous aurions pu être quatre cents, quatre mille même, sans exagération, parce que ça jouait vraiment du tonnerre. D’explosions en explosions, de ravissement en ravissement, le show tenait ses promesses et amenait de nouvelles surprises. Je me suis laissée prendre dans ses montagnes russes, ses accélérations exaltées, et à chaque pic d’adrénaline, il y avait la voix mélodieuse de Vincent pour me recueillir ; cette voix puissante et juvénile qu’il sait voiler parfois avec une aisance déconcertante, et qui semble remonter de tout son corps depuis ses jambes mobiles et jusqu’à la pointe de ses cheveux, comme pré-amplifiée dans l’électricité de ses doigts arrimés à sa guitare – qui n’est déjà plus qu’une extension naturelle de sa silhouette ondulante.
RADIO ELVIS
Il est arrivé, avec sa marinière, sa guitare, ses lunettes, il a pris possession de la scène devant un public encore clairsemé, s’est présenté : «Bonjour, je suis Radio Elvis, bienvenue, j’espère que ce sera bien». Cette entrée en matière augurait une mise à mort par l’audience tant l’homme semble humble et hésitant. Il n’en fut rien.
Radio Elvis, c’est avant tout rêche, sec, énervé. Il n’avait pas besoin de se défendre, pourtant il semblait avoir un «putain de truc à nous dire», parce sous ses (faux) airs du gars s’excusant presque d’être là, Radio Elvis est venu calmement pour en découdre.
Peut-être est-ce certaines de ses sources d’inspirations, la mer, la rudesse de ses paysages, les marins qui la labourent, qui le poussent à remuer son public. On se laisse un peu aller mais on imaginerait celui qui dans le brouhaha d’un bar à marins de la rade, aurait sa place à gagner, ses chansons à faire valoir, devant un public plus préoccupé de noyer la dureté et le romantisme du travail de la mer dans la dernière expérience alcoolisée de la place.
Attention, restons focus, ne partez pas chercher le dernier gueulard de banalités sur la rigueur des flots et la bonne grosse camaraderie du bord. Radio Elvis est inspiré, proche d’une réalité faite de questions nettement plus contemplatives et hautes que la complainte facile et sale. Il pourrait être le héraut de ces gens simples et embarqués, prisonniers d’une image d’Épinal qui leur colle cradement à la peau.
Les images sont belles, le voyage présent. Radio Elvis ne vous quitte pas des yeux lorsqu’il nous fait part de l’arrivée d’un peuple entier et hanté sur le continent, et vous emmène avec les variations et reprises de ses compositions dans sa traversée. On sent l’homme habité, celui qui est venu là pour proposer une expérience.
S’il y en a qui n’assument pas, qui se cachent derrière une production vocale éthérée et numérique, Radio Elvis a une voix qu’il met au premier plan, lui. La voix franche et rugueuse vous cherche et nous fait part de son message, de ses impressions marines, de sa quête d’une terre inconnue, de manière haute et claire. Sans emphase ni envolée, elle s’immisce et larde la première impression et l’attente primaire suscitée par son patronyme.
Radio Elvis à l’instar de ses glorieux ainés porte haut les couleurs d’un rock en français, anguleux et inspiré.
Par Fabien Hellier
Crédit photo : Marguerite de Vdn